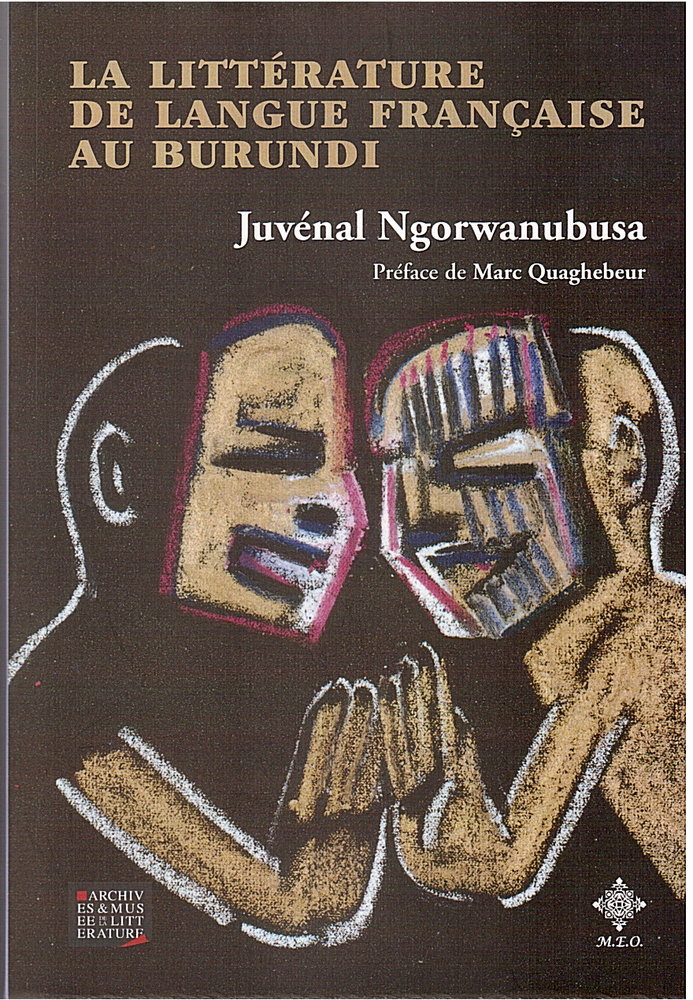Juvénal Ngorwanubusa, La littérature de langue française au Burundi, Histoire/anthologie, préface de Marc Quaghebeur, A.M.L.-M.E.O., 328 pp, 22 €.
Une remarque préalable, et qui me paraît importante: si l’histoire du Burundi jusqu’à l’indépendance en 1962 ressort clairement de l’exposé fait, au début du livre, de l’histoire de la langue (pas seulement la française, car les langues endogènes ont aussi leur mot à dire), il n’en va pas de même de l’histoire du pays après l’indépendance: elle est bien évoquée, en termes voilés, il est question de massacres survenus à différents moments, mais cela reste flou, enveloppé. Des atrocités, bien sûr; commises par qui et contre qui, cela n’est pas toujours dit clairement. On peut comprendre qu’il y ait là, chez l’auteur, une sorte de gêne, source de restrictions mentales, mais l’impasse ainsi faite est assez déroutante pour le lecteur.
En ce qui concerne l’histoire de la langue, il s’est passé là un phénomène assez curieux: avant la prise en main du pays par l’Allemagne, vers 1910, les Pères blancs du cardinal Lavigerie étaient déjà solidement installés. Leur politique, reprise par les Allemands, était de favoriser uniquement, dans les écoles, l’apprentissage des langues endogènes – par crainte surtout des problèmes que ne manqueraient pas de soulever les « évolués » ébentuels. Les Belges, maîtres du pays à partir de 1916, et qui se verront confier un mandat international après la guerre, continuent dans le même sens. Rien ou pas grand-chose n’est fait pour favoriser l’apprentissage du français. On le reculera jusqu’au plus tard possible dans le cursus scolaire. C’est seulement après la seconde guerre mondiale que la situation se modifiera en profondeur, et que l’ enseignement du français sera véritablement organisé, avec des décalages importants entre la ville et la campagne. Un nouveau personnage va faire surface: l’évolué, qui sera assez souvent coupé de son milieu d’origine, et que certains textes littéraires ne manqueront pas de brocarder. Ce mouvement s’accentuera à partir de l’indépendance. Mais un courant d’opinion naîtra, de même que dans d’autres pays africains, qui prônera un retour aux langues maternelles. Suivant ces théories, reprises dans le programme de 1968, le français n’apparaît plus que comme une langue seconde, derrière le kirundi, et une langue essentiellement orale, permettant simplement de se faire comprendre. Ceci sera encore accentué par le projet de réforme de 1973, placé sous le signe de la kirundisation et de la ruralisation. Et puis, en 1975, on fera marche arrière ^pour favoriser à nouveau l’étude du français…et tout ceci laissera bien sûr des traces dans l’enseignement.
La littérature aura un développement à peu près parallèle, marqué par une grande lenteur, et certains textes sont très révélateurs. Ainsi, le P.Albert Mauss, dans la revue Grands Lacs en 1940: C’est pour garantir cette supériorité, cette domination du colonisateur que pour l’élite indigène, l’instruction, surtout littéraire, ne devra guère dépasser celle de la masse.
On comprendra aisément, au vu de la politique d’enseignement du français menée par le colonisateur, qu’en un premier temps les ouvrages publiés étaient surtout le fait des missionnaires eux-mêmes, avec des vues essentiellement pratiques: permettre aux Européens en général, aux missionnaires en particulier, de pratiquer sans problèmes les langues indigènes (grammaires, lexiques…), épauler et illustrer d’historiettes et d’apologues le travail de christianisation. Lorsque des Burundais eux-mêmes se mettront à écrire, ce seront d’abord des prêtres, et les récits qu’ils produisent resteront tout aussi édifiants. Un nom ressort surtout, dans les années 60: Michel Kayoya, prêtre lui aussi, avec surtout Sur les traces de mon père, et Entre deux mondes, un récit autobiographique. Il dénonce le sous-développement, le rôle mineur laissé aux femmes, les méfaits de la boisson, le parasitisme social .Dans le domaine de la politique,, il s’en prend à la colonisation, mais rejette à la fois le capitalisme et le communisme. Il se réfugie dans la défense des valeurs traditionnelles, la paysannerie, la vie simple, la religion bien comprise et axée elle-même sur des valeurs ancestrales. A noter notamment l’importance de la vache chez ce peuple pastoral, importance qui va plus loin que le seul rôle économique et acquiert une véritable valeur religieuse, répercutée dans la littérature.
Dans les années 1970 et suivantes, c’est le théâtre surtout qui sera florissant. Et, dans les années 80-90, c’est une femme, Marie-Louise Sibazuri, qui tiendra le premier rôle. Elle écrit en kirundi aussi bien qu’en français, et les problèmes de société tiennent la première place dans son œuvre, avec, bien sûr, la place et le rôle de la femme. Mais la guerre civile, les massacres, l’insécurité, ont grandement ralenti l’épanouissement de cette littérature. Il en va de même en poésie, assez souvent l’auteur mentionnera qu’un poète est réfugié au Rwanda, un autre aux Etats-Unis…Par ailleurs, selon lui, le roman est le maillon faible de cette littérature, et il cite Joseph Cimpaye, auteur de L’homme de ma colline, Celui-ci, après avoir été premier ministre à l’indépendance, sera par la suite incarcéré, incarcéré une nouvelle fois en 1972, et exécuté lors du soulèvement ethnique hutu. Son roman a été écrit en prison. Un roman historique, les Tourments d’un roi de A.Nindorera, mais il s’agit de tentatives isolées. Par la suite, des romans autobiographiques, où tradition et modernité sont à nouveau confrontées, avec assez souvent une préférence marquée pour la première. Enfin, la nouvelle, le genre dernier-né, pratiqué d’abord par Sébastien Katihabwa, où l’on retrouve les thèmes et les oppositions du roman.
La seconde partie diu livre étudie en détail les thèmes développés: Tradition versus modernité, l’institution des Bashingantahe, détenteurs du savoir profond, savants en matières traditionnelles, La femme traditionnelle, l’insertion de l’oralité dans le texte français, la tentation de la fuite vers l »Uganda, les évolués et la ville. Chacun de ces thèmes sera illustré par des extraits d’œuvres, certains poignants dans leur dénonciation des massacres, ainsi celui de D.Niyonzima, tiré d’Héritiers du nouveau monde, p.258:
Tant de tantes transpercées
Traumatisées, torturées, tuées
Tant de Pères pourchassés, persécutés(…)
Tant de mères mortes, massacrées
Tant d’enfants errants
Dans les rues, sous les huées
La terreur règne sur toute la nation
Nous vivons le deuil.
C’est ainsi que brillent, comme de purs diamants, quelques textes qui célèbrent avec
naïveté les beautés du pays et de ses collines, qui déplorent les massacres, au
milieu de beaucoup d’autres qui sont de simples publicités pour une foi religieuse,
un idéal patriotique ou politique. Le prix à payer pour la naissance d’une littérature
véritable, ayant pris ses distances avec ses origines missionnaires? Sans doute. Faut-il
comme le dit Georges Jacques, cité par Marc Quaghebeur dans sa préface, p19,
privilégier les meilleurs talents si l’on ne veut pas s’exposer à rendre un mauvais service
à une littérature? Pour notre part, nous le pensons; mais cela nécessite dans le cas
présent une mise à distance des prises de position idéologiques et religieuses. On sait
à suffisance combien les deux ont été intimement liées, avec des conséquences dramatiques.
Certains de ces textes – nécessaires – sont d’ailleurs comme des
conjurations de la violence déchaînée; c’est seulement quand les sources profondes
en auront été clairement reconnues, et que l’on aura procédé à la prise de distance
nécessaire (qui est tout le contraire d’une mise sous le boisseau) que pourra naître une
littérature réellement indépendante.
Joseph Bodson